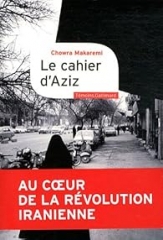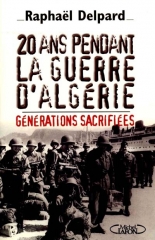… The iron heel
Traduit de l’Américain par Philippe Mortimer, éditions Libertalia 2018, publié aux États Unis d’Amérique en février 1908.
Un récit d’anticipation et un classique de la Révolte, appartenant au Patrimoine Mondial de la Littérature…
Soit dit en passant, il n’y avait pas en 1908 comme de nos jours, d’intelligence artificielle générative pour « aider » les écrivains à rédiger un roman, un essai ou un récit… Mais déjà à l’époque il existait, bien présent, tel un « talon de fer », un Ordre du Monde, l’ordre d’une société et d’une économie capitaliste ( et dans certains pays totalitaire et fasciste) , de firmes et d’actionnaires, et des médias, des journalistes, des écoles, des universités, des scientifiques, des « nervis », des avocats, des juristes… Et « toute une morale » et l’appui de la Religion, tout cela au servive des dominants, des possédants, des « maîtres du monde » de l’époque…
Et toute création – artistique, littéraitre – et toute réalisation, invention, en quelque domaine d’activité que ce soit ; à l’époque de Jack London, se devait dans l’Ordre du Monde d’une société d’économie capitaliste, d’avoir « une valeur marchande » autant que possible achetable par un grand nombre de gens auxquels il fallait plaire – et non pas déranger dans leur manière de penser…
Abraham Lincoln Président des États Unis d’Amérique élu en 1860, réélu en 1864, né le 12 février 1809 et assassiné le 15 avril 1865 à Washington DC, avait déclaré peu de temps avant sa mort :
« Je vois venir, dans un avenir proche, une crise qui m’angoisse au plus haut point et me fait trembler pour la sûreté de mon pays… Les grandes firmes sont montées sur le trône, et une ère de corruption en haut lieu s’ensuivra ; les puissances de l’argent de ce pays feront tout leur possible pour prolonger leur règne en s’appuyant sur les préjugés populaires, jusqu’à ce que le gros de la richesse se trouve concentré entre quelques mains, et que la République soit détruite »…
Ces grandes firmes ou consortiums ou multinationales – au Moyen Age, et aux 16ème et 17ème siècle en Europe c’étaient des Guildes marchandes – et leurs assemblées d’actionnaires principaux auquelles s’ajoutent des centaines de milliers d’autres actionnaires « petits porteurs », exercent sur le monde, sur les peuples (sur les gens qui ne sont pas eux, des actionnaires) une pression comme celle d’un « talon de fer » qui écrase…
Les domaines essentiels à la société humaine tels que ceux de l’alimentation, de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie, de la médecine et de la pharmacie, de l’école, de l’université, de la science, des arts et de la littérature, de l’entreprenariat artisanal et commerçant, de toutes les activités humaines … Ont été pris d’assaut par les oligarchies dominantes… Et de surcroît les marchands d’armes et les trafiquants de toutes sortes, et ce que l’on appelle la « Réal-politique » se sont mis de la partie…
D’où les deux grandes guerres mondiales du 20ème siècle, les guerres du 21ème siècle et toutes les guerres à venir (les guerres devenant de plus en plus technologiques)…
Il n’y a que la Terre toute entière, épuisée, pillée de la plupart de ses ressources essentielles à la vie humaine, souillée, abîmée, et devenue en partie désertifiée, qui, par ses colères d’une violence extrême sous la forme d’intempéries, d’incendies, d’éboulements gigantestesques, d’ouragans, de tornades, d’innondations… Qui pourra broyer le « talon de fer » ! … Et ainsi, mettre dans la nécessité – l’obligation en somme – pour les survivants, de revoir la gestion et l’organisation de la société humaine… Jusqu’à ce que revienne « un autre Talon de fer »…